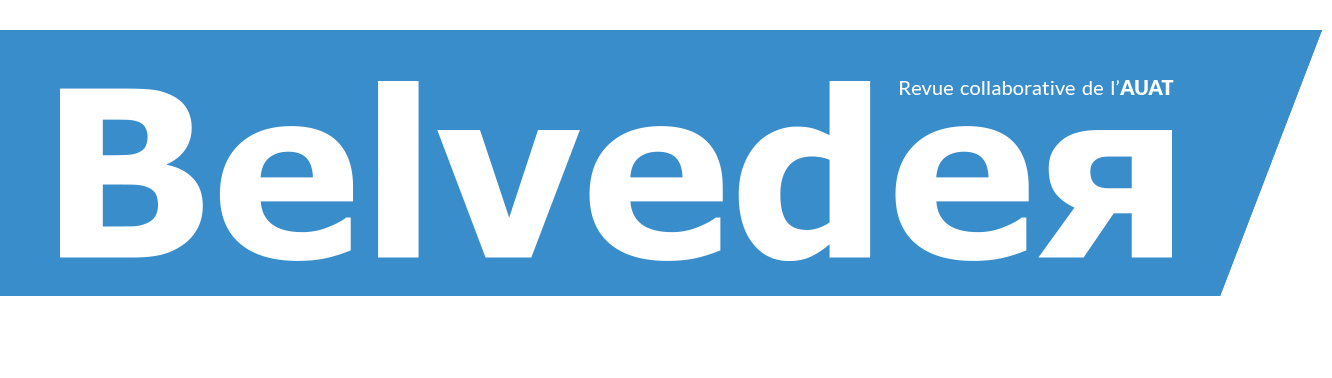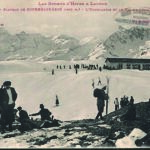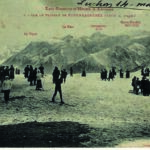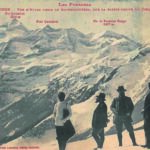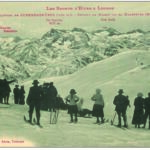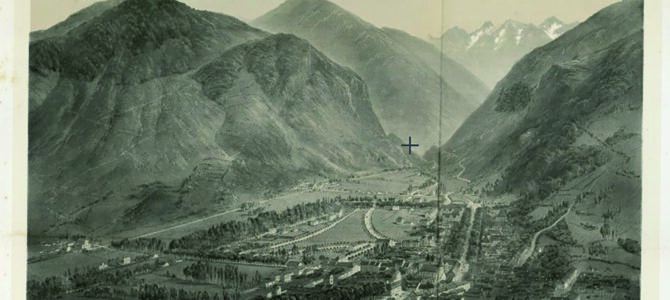
Téléchargez l’article au format PDF
Steve HAGIMONT
Maître de conférences en histoire contemporaine, Membre du Laboratoire des sciences sociales du politique (LaSSP), Sciences-Po Toulouse
Au milieu du XIXe siècle, arrivant dans le Midi toulousain, l’écrivain et historien Jules Michelet se réjouissait de voir à l’horizon « ce nuage incertain, réel pourtant, qui par moments reparaissait, cette barrière d'un monde » : les Pyrénées. Cela faisait déjà plusieurs décennies que la bonne société cultivée se pressait dans des bourgades du massif, à la recherche d’eaux curatives, d’un air moins « vicié » que dans les villes, de populations censées être préservées des tourments politiques incessants, d’une faune et d’une flore pittoresques, et de paysages grandioses donnant à voir la puissance de la création divine.
La naissance du tourisme estival : entre désirs de nature, concurrence des sites et mobilisation de la nature
Le développement du tourisme dans les Pyrénées françaises centrales et occidentales est en effet concomitant du grand engouement pour les eaux thermales et les paysages de montagne, qui gagne l’Europe au XVIIIe siècle. Le tourisme, en tant que système articulant des désirs de voyages et une offre de transport, d’hébergements et de loisirs, connaît ses premiers développements autour de quelques villes et des montagnes d’Europe centrale, de la Forêt Noire, des Alpes du Nord et, donc, des Pyrénées. Passion de quelques aristocrates, y trouvant des lieux de distinction et de délectation esthétique, curiosité de savants désirant y déchiffrer l’histoire de la Terre, nécessité curative pour des malades, les montagnes accueillent ainsi des flux plus ou moins massifs dès la fin du XVIIIe siècle (de quelques centaines de personnes, surtout anglaises, à Chamonix, à quelques milliers à Spa, Baden- Baden ou Bagnères-de-Bigorre).
Ce mouvement de personnes ne laisse pas indifférent : propriétaires fonciers, autorités municipales, provinciales et royales y voient une opportunité économique à saisir. Les eaux thermales, l’air et les paysages de montagne deviennent, dès la fin du XVIIIe siècle, des ressources valorisées sur un marché européen. Dans les Pyrénées, un argument est déjà avancé : comme les vallées sont à l’écart de l’industrialisation connue par d’autres régions, cette « industrie des étrangers » est la meilleure chance de survie pour les communautés montagnardes – et, à leur tête, pour les principales familles disposant de foncier et d’argent à valoriser par l’immobilier.
La sélection des sites touristiques est drastique : nombre de lieux disposant d’eaux thermales ne tiennent pas la concurrence exacerbée. Entre la fin du XVIIIe siècle et le milieu du XIXe, la recette semble assez systématique : les stations thermales et touristiques qui émergent dans les Pyrénées disposent d’un appui financier public fort pour organiser l’espace de villégiature (par le financement de plans d’urbanisme, puis la modernisation des voiries, de l’éclairage et des réseaux d’eau) et pour bâtir des établissements thermaux à la hauteur de ce qui se fait de mieux ailleurs. Successivement, Luchon, Bagnères, Cauterets, Eaux-Bonnes, puis à nouveau Luchon, avec les thermes Chambert en 1852, réussissent ainsi à inaugurer des bains qui sont, pour un temps, des modèles en Europe – rapidement menacés d’obsolescence. Les pouvoirs publics font aussi édifier des chemins d’excursion et réglementent le métier de guide. Les sommes nécessaires à la mise en place et à la maintenance de cette infrastructure proviennent au départ d’une autre ressource : les forêts. Là où les communes et syndicats de vallée (organisations collectives ayant la gestion des estives, des forêts et, souvent, des eaux) disposent de forêts, les aménagements sont rendus possibles par le produit de coupes d’ampleur et les garanties d’emprunts. Ailleurs, les acteurs locaux désireux de se lancer dans le tourisme sont impuissants – Ax en est un exemple.
L’arrivée du chemin de fer : coup d’accélérateur du tourisme et croissance des emprises des stations
Le chemin de fer, plus qu’un point d’origine du tourisme, vient conforter l’élan des stations raccordées : Bagnères-de-Bigorre en 1865, Luchon en 1873, tandis que Cauterets bénéficie de la proximité de la gare de Pierrefitte avant que n’y arrive le premier train électrique pyrénéen en 1898. Le chemin de fer facilite aussi l’approvisionnement alimentaire (pour les touristes, les saisonniers, et les chevaux, indispensables aux excursions avant que l’automobile ne les remplace autour de la Première Guerre mondiale) et en matériaux qui servent à bâtir villas et hôtels.
Le chemin de fer coïncide néanmoins avec un tournant de l’histoire du tourisme : les volumes d’investissement effectués ailleurs en Europe dépassent désormais les capacités publiques. La demande est aux grands hôtels, aux casinos luxueux, aux théâtres et aux thermes de plus en plus perfectionnés. Des formes de délégation de l’aménagement au secteur privé sont donc opérées à partir des années 1860. Les sociétés anonymes touristiques naissent, prenant en charge l’organisation de l’espace et des loisirs dans les stations, et avec elles, de vives tensions public-privé – et parfois, aussi, des scandales financiers. Autre tournant : avec les chemins de fer (à vapeur), le tourisme entre dans l’ère des énergies fossiles.
À partir des années 1880, les chemins de fer funiculaires et à crémaillère sont capables de vaincre de forts dénivelés et d’atteindre des sommets. La Suisse montre l’exemple et certains, en France, espèrent faire de même. L’ampleur des investissements est souvent rédhibitoire. De premières craintes s’expriment aussi contre la « profanation » des montagnes par des équipements lourds. En 1912, Luchon inaugure toutefois la crémaillère de Superbagnères, qui lui permet de se lancer sans retard dans la nouvelle course touristique : les sports d’hiver.
L’avènement contrarié des sports d’hiver : les débuts de l’urbanisation en altitude et de la pétrolisation du tourisme
La saison des sports d’hiver s’installe en effet en Europe de l’Ouest dans les années 1900. Luge, patinage et ski nordique offrent l’opportunité tant espérée de compléter la saison d’été. Mais le marché est longtemps fragile : si les stations suisses attirent les touristes internationaux, en France, le nombre de skieurs est faible. Superbagnères est lancée alors que la vogue semble prendre, mais que le ski alpin est encore inconnu. L’investissement est réussi, tout comme à Font-Romeu, mais les deux stations s’avèrent néanmoins limitées pour suivre l’expansion du ski alpin, surtout après 1945.
Dans un premier temps, les collectivités territoriales sont en retrait : ce sont des investisseurs privés qui se risquent dans les sports d’hiver. Mais, dès les années 1930, tandis que des sites des Alpes françaises décollent (Val d’Isère, l’Alpe d’Huez, Megève, etc.), les communes pyrénéennes tentent d’impulser leurs propres aménagements, centrés sur les villages existants en vallée, reliés par des routes ou des téléphériques aux domaines skiables dont l’urbanisation est strictement limitée. Cet éloignement des champs de neige et les lourds investissements consentis pour les remontées mécaniques déséquilibrent les exploitations. À partir de 1960, en dehors de Cauterets, la plupart des stations hivernales pyrénéennes acceptent les urbanisations en altitude, qui permettent au moins de valoriser du foncier, jusque-là sans grande valeur immobilière.
Ces sports d’hiver participent pleinement à la pétrolisation du tourisme. Le transport ferroviaire se maintient longtemps, mais routes carrossables, parkings, villas avec garages grignotent l’espace. La voiture individuelle favorise aussi l’expansion des résidences secondaires, dont la part grimpe à partir des années 1960. Dans les stations anciennes, cela se fait au détriment des hôtels hérités du XIXe siècle, qui ferment un à un, et, partout, au détriment des résidences principales, dans un contexte d’érosion démographique. Nombre de communes pyrénéennes présentent une part de résidences secondaires dans le total de logements qui dépasse les 80 %. Ces résidences, ressources de base des stations de ski, sont sous-utilisées (on parle de lits « froids », sortis du marché des hébergements touristiques) et nourrissent une fuite en avant immobilière jamais réellement résorbée. Si la clientèle la plus fortunée a gagné d’autres horizons, les Pyrénées françaises conservent une vogue certaine en été, qui concentre toujours la majorité des nuitées touristiques. L’Espagne, et surtout l’Andorre, s’envolent quant à elles grâce au ski.
Tourisme et protection de l’environnement : entre alliances et contestations
Le tourisme stimule par ailleurs les contestations environnementales. D’abord en tant que support : à partir des années 1900, l’hydroélectricité et ses grands équipements provoquent la mobilisation des acteurs du tourisme, qui entendent sauver des paysages devenus patrimoine national. Gavarnie, Gaube, Oô et d’autres sont le théâtre de batailles qui se concluent par quelques victoires, toujours temporaires, et de nombreuses défaites face aux impérieux besoins industriels.
Allié de la protection de la nature, au point d’être central dans la création des parcs nationaux (celui des Pyrénées est inauguré en 1967), le tourisme devient néanmoins la cible des défenseurs de la nature, en particulier avec l’essor des sports d’hiver (entraînant routes, remontées mécaniques, défrichements, terrassements, lotissements, etc.). À partir des années 1970, comme ailleurs en Occident, nombre de projets de stations sont bloqués par la mauvaise conjoncture économique et par des mobilisations. Dans les Pyrénées, l’une des luttes les plus emblématiques est celle de la SEPANSO[1] Béarn, qui empêche l’urbanisation du vallon de Soussouéou, en Ossau, dans les années 1970.
Tumultueux avec l’industrie, les rapports du tourisme avec l’agri- culture et le pastoralisme méritent un mot pour finir. Le pastoralisme, d’abord révéré, se mue au XIXe siècle en archaïsme à faire disparaître. La modernisation agricole accélérée fait toutefois qu’il devient, après la Seconde Guerre mondiale, un patrimoine à sauvegarder. Par ailleurs, le tourisme offre aux populations les plus modestes des débouchés pour les surplus agricoles et des opportunités d’emplois saisonniers, subalternes. En même temps, depuis le XIXe siècle, l’emprise foncière du tourisme a concurrencé les meilleures terres agricoles, nécessaires à l’autonomie des exploitations, hâtant leur transformation.
Les Pyrénées touristiques témoignent ainsi d’une partie de l’ambivalence de l’histoire contemporaine, qui voit converger, d’une part, les désirs de nature préservée des atteintes du développement urbain et industriel et, d’autre part, une intégration accrue de leurs milieux aux circulations économiques internationales, porteuses d’enrichissement et de marginalisation pour de tels territoires ruraux.
[1] SEPANSO : Société pour l’étude, la protection et l’aménagement de la nature dans le Sud-Ouest.
©Bibliothèque municipale de Toulouse